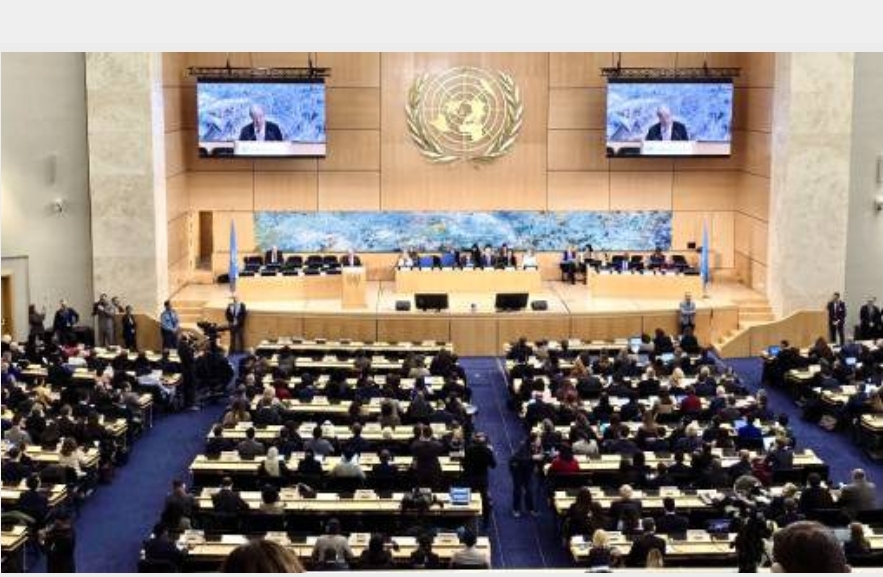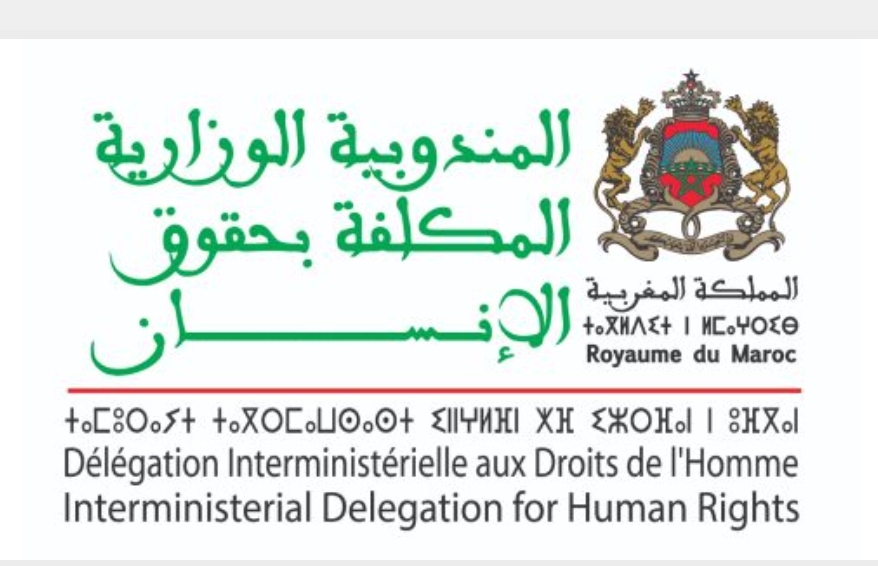Assahafa – Par : Abderrahman Adraoui
Directeur du journal électronique Assahafa
Préface :
Je ne pense pas qu’il existe un désert bénéficiant d’une protection militaire plus certaine, d’après l’expérience de plusieurs guerres, que notre désert ; mais peut-être n’existe-t-il pas non plus de peuple qui, politiquement, se détourne autant de son désert et l’ignore sur le plan touristique, culturel et scientifique, comme le peuple marocain.
L’existence : engagement et sauvageonnement
Le désert est notre désert, et cela suffit, situé au sud ; sans continuer à insister indéfiniment sur le fait qu’il est marocain.
Y a-t-il besoin d’appeler la région de l’Est – par exemple – marocaine ? Nous ne devrions pas rester constamment obligés, chaque fois que l’on parle du désert, de lire notre histoire et notre géographie aux autres ; car l’appellation « marocain » qui revient automatiquement sur nos lèvres, après la résolution de l’ONU 2729, n’est plus qu’un excédent de plaidoyer inutile ; elle peut même nuire à notre cause, car elle incite les autres à se méfier d’une affirmation pressante sans fin.
Il n’y a là aucune xénophobie ; et il ne fait aucun doute que les Marocains du désert, qu’ils soient partisans de l’unité ou séparatistes – historiquement, actuellement et à l’avenir – remplissent toutes les conditions de la citoyenneté.
Même les séparatistes les plus extrêmes reconnaissent leur marocanité, dans leur revendication qui n’est que séparatiste, et non identitaire :
Ils sont Marocains, oui, mais ils souhaitent posséder une propriété marocaine, enregistrée au niveau international à leur nom.
Les séparatistes ont choisi – ou on les a poussés – à vivre de manière aléatoire (provocante) à « Tindouf » ; alors que des villes marocaines sont prêtes à les accueillir, dans toutes les régions, et pas seulement dans le désert.
Quant à ceux qui renient leur marocanité – comme on l’a entendu récemment – ils se comparent à des renards, des loups et des hyènes du désert, répandus de façon sauvage dans la région.
Il est évident que cette revendication séparatiste, souvent foncière – sauf dans les cas d’anti-colonialisme – est courante dans le monde ; elle est liée aux périodes lointaines de l’évolution des sociétés humaines, depuis un état sans contraintes dans la vie quotidienne, la dispersion pacifique ou conflictuelle ; jusqu’à l’établissement de l’État et du pouvoir central.
Si tous les pays concernés aujourd’hui répondaient à la demande de séparation, nous assisterions à une prolifération d’États, semblable à la division cellulaire dans le domaine biologique ; ce qui aurait des conséquences importantes pour un ordre mondial tendant vers la globalisation. Un système solide institutionnellement, mais rongé par des guerres et des problèmes humanitaires innombrables ; en plus de dilemmes idéologiques hérités de l’histoire, que les solutions du système international – pacifiques ou militaires – ne font qu’aggraver.
Ainsi, le désert ne bénéficiera pas de l’insistance répétée sur sa marocanité ; mais de la rééducation des citoyens – tous – à garder constamment en mémoire leur dimension saharienne ; comme ils gardent à l’esprit leur dimension maritime, fluviale, montagneuse, forestière ; une éducation spatiale et territoriale, rien de plus.
La leçon inaugurale, présente dans la Marche Verte, est exactement celle-ci. Ce sont les citoyens civils qui ont libéré le désert ; les militaires n’y sont intervenus que pour les protéger contre des agressions extérieures.
Pourquoi dans notre éducation sur le désert, la dimension politique est-elle la seule mise en avant ?
Les déserts les mieux protégés du monde
J’ai déjà parlé de la doctrine militaire marocaine, et j’ai attribué sa formation – école parmi les écoles mondiales – au désert ; depuis la guerre des Sables, en passant par toutes les autres guerres sahariennes qui nous ont apporté des victoires, parce que nous étions des défenseurs et non des agresseurs.
Pourquoi continuons-nous à avoir ce complexe de peur, et à cantonner le désert dans un angle politique étroit, au lieu d’en faire un sujet d’éducation à la citoyenneté, théorique et pratique ?
Pourquoi les camps scolaires ne sont-ils pas organisés dans le désert ?
Pourquoi nos cinéastes redoutent-ils d’ouvrir le désert aux Marocains et au monde ?
Pourquoi les équipes de recherche spécialisées, dans nos universités, ne descendent-elles pas dans le désert pour suivre les pas des scientifiques, comme “Monod”, et révéler les secrets de ce monde qui a fasciné les Européens au XIXe siècle, au point qu’ils ont risqué leur vie ? Pourquoi ignorons-nous un domaine qui a consolidé l’État marocain à travers l’histoire ?
Je ne pense pas qu’il existe un désert bénéficiant d’une protection militaire plus certaine, d’après l’expérience de plusieurs guerres, que notre désert ; mais peut-être n’existe-t-il pas de peuple qui, politiquement, se détourne autant de son désert et l’ignore sur le plan touristique, culturel et scientifique, comme le peuple marocain.
Encore une fois, au lieu de la formule évidente (« le désert est marocain »), il faut penser à une feuille de route qui maintienne toutes les dimensions du désert vivantes et présentes dans la conscience des citoyens.
Le désert est notre patrie ; l’alphabet de la citoyenneté est l’amour du pays, l’amour du connaisseur soufi ; et non du propriétaire foncier.
Le monde autour de nous connaît les efforts de développement fournis dans le désert ; il sait qu’après « La ilaha illa Allah, Muhammad rasul Allah », les Marocains ne témoignent que de la marocanité du désert ; mais il sait aussi que la grande majorité des Marocains n’a jamais foulé le sable du désert, ni goûté à sa mer, ni campé avec ses habitants.
Est-ce le cas des citoyens des pays scandinaves, par exemple, avec leurs régions glaciales et enneigées ? Les frontières de la citoyenneté suédoise se limitent-elles aux villes chaudes ? Je ne pense pas.
Les rares pays qui doutent de la marocanité de notre désert ne font face qu’au discours officiel de l’État, et ignorent complètement le sentiment des Marocains envers leur désert ; car les porteurs de ce sentiment sont rares ou inexistants. Le monde doit savoir à quel point les Marocains aiment leur espace saharien, et pas seulement leur carte politique.
Même nos ambassades à l’étranger ne prennent en compte cette dimension que partiellement ; car elles restent des ambassades défendant la marocanité du désert, et non la dimension saharienne du citoyen marocain, même si celui-ci est de Tanger.
La culture de l’autonomie
Je pense que le plus difficile pour les négociations sur l’autonomie, puis sa mise en œuvre consensuelle, est l’aspect culturel.
Ni la propriété, ni les partis politiques, ni le palais royal ne manqueront pour actualiser et compléter la formule de l’autonomie, que l’ONU réclame avec insistance.
Et il ne manquera pas de juristes marocains – voire étrangers – pour construire l’arsenal légal de l’autonomie (son code, si je peux le proposer).
Quand tout cela sera stabilisé au Maroc, commencera la phase de plaidoyer ; car l’autre partie, lorsqu’elle déposera les armes, ne disposera que de son arsenal « juridique », avec lequel elle pourra argumenter et exiger.
Même ce plaidoyer, malgré sa difficulté – en raison de la présence d’une partie externe incitatrice ou corruptrice – relève de la diplomatie marocaine, qui a marqué les tribunes de l’ONU.
Mais la force douce, formée par la culture : la culture de l’autonomie ; est ce qui peut conduire la résolution de l’ONU à produire tous ses effets positifs, et faire entrer la région maghrébine dans une nouvelle phase de construction.
Si tous les éléments de cette force font défaut, ou si elle ne fonctionne pas correctement, ou si quelqu’un l’affaiblit de l’extérieur ; les résultats seront décourageants, et mortels pour tous les désirs et rêves.
Et après l’échec, il ne restera que le recommencement.
Avec le lancement des consultations politiques par Sa Majesté le Roi, avec les partis représentés au Parlement, pour présenter la formule actualisée de l’autonomie ; j’espère, et je prévois, que l’action culturelle préparatoire à l’autonomie ne sera pas absente.
Cette action forme un troisième front – quasi neutre – dans lequel s’engagent les intellectuels des deux parties, pour établir un discours éducatif et culturel unifié, qui formera – à l’avenir – l’esprit de l’autonomie, une fois qu’elle deviendra un système politique et juridique, nouveau au Royaume ; à l’instar de ce qui se pratique dans de nombreuses démocraties dans le monde.
Malgré la disponibilité de nombreux éléments de réussite de ce front, ou de cette force douce, il y aura des difficultés considérables ; car un demi-siècle d’éducation à l’hostilité envers la patrie mère ne sera pas compensé par quelques mois ou années de travail culturel intégré et pacificateur.
Ceci, si l’Algérie cesse de détruire la culture saharienne marocaine ; sinon, les difficultés se multiplieront.
Quoi qu’il en soit – et les consultations royales politiques ont commencé – nos intellectuels doivent avancer dès maintenant pour actualiser le discours culturel, qui clarifiera le sens de l’autonomie.
Sans ce sens, le débat restera un terrain de méfiance, de suspicion et de recul ; et ce n’est jamais ce qui construit des fédérations réussies dans le monde.