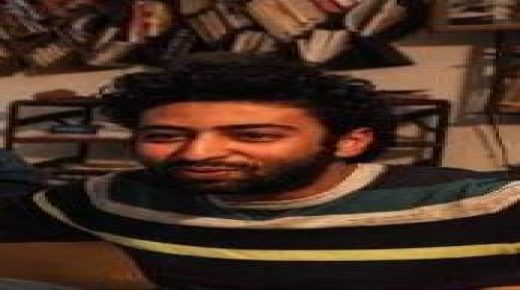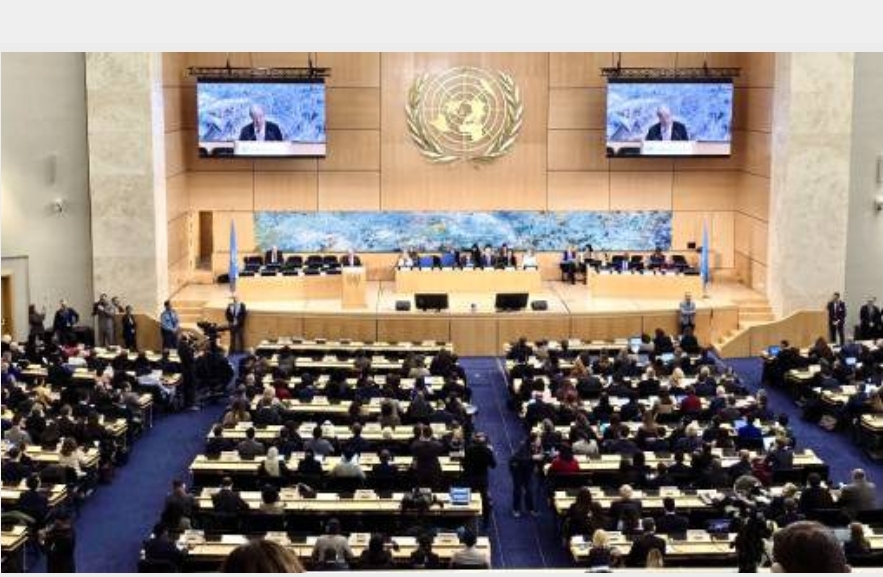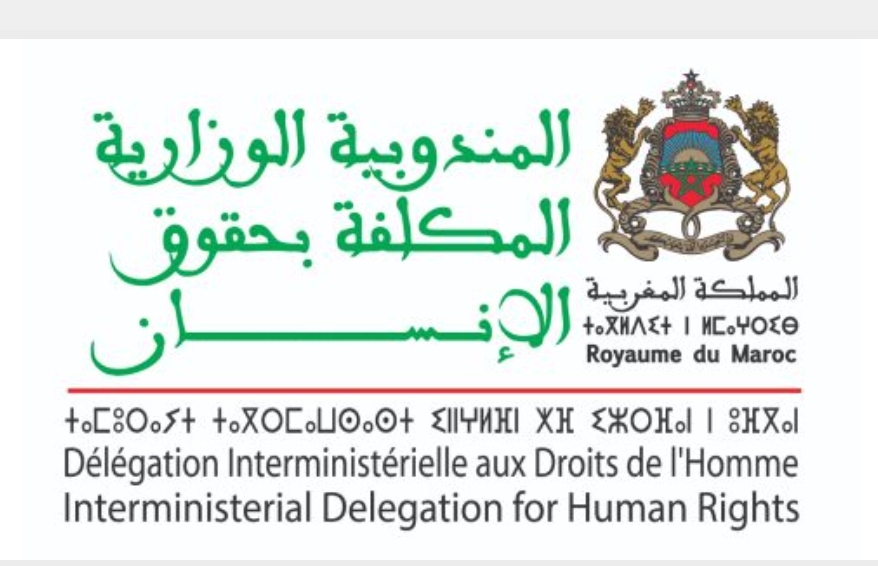Assahafa – Par : Abderrahman Adraoui
Directeur du journal électronique Assahafa
À un an des élections législatives, le Premier ministre Aziz Akhannouch a choisi d’apparaître sur la télévision nationale pour dresser le bilan de son action. Au cœur de ses déclarations : la question cruciale de l’eau. Il affirme avoir hérité d’une « grave crise », décrivant une situation où Casablanca et Rabat risquaient de perdre leur approvisionnement en eau potable quelques mois seulement après son entrée en fonction, en raison d’un long retard dans les projets structurels, notamment le dessalement.
Derrière ce discours défensif se cache pourtant une contradiction majeure. Akhannouch n’est pas un homme arrivé soudainement au pouvoir : il a été ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural pendant quatorze années consécutives (oui, quatorze !), sous quatre gouvernements successifs. Ses responsabilités incluaient précisément les politiques rurales et hydriques, ainsi que la gestion du Fonds de développement rural, véritable levier stratégique pour préparer les territoires aux défis climatiques. À cela s’ajoute sa fonction de chef du RNI depuis 2016, parti central dans les coalitions gouvernementales de la dernière décennie. Autrement dit, il n’était pas un simple observateur : il faisait partie des principaux architectes des politiques publiques.
Pourtant, en se retranchant derrière l’argument de « l’héritage lourd », Akhannouch opère une double occultation : celle de son propre parcours, et celle de la responsabilité collective des gouvernements auxquels il appartenait. Cette manœuvre vise à faire porter le poids politique sur les exécutifs précédents, comme s’il n’en avait pas été un acteur essentiel, alors que les faits restent indiscutables. On ne peut résumer quatorze ans de responsabilités en une formule destinée à sacrifier les institutions.
À ce glissement discursif s’ajoute son insistance sur la « transparence » des appels d’offres, notamment celui de l’usine de dessalement de Casablanca, attribué à un consortium maroco-espagnol. Mais ce récit se heurte à des doutes persistants : le chevauchement entre décisions publiques et intérêts privés dans un secteur aussi stratégique que l’eau. Et le fait que le chef du gouvernement soit lui-même l’un des plus grands acteurs économiques du pays rend l’examen public encore plus nécessaire. L’invocation du respect des procédures ne suffit pas : seule la publication complète des contrats, un contrôle indépendant des financements et un audit transparent des décisions antérieures peuvent restaurer la confiance.
Politiquement, cette stratégie révèle une forme de gouvernance fondée sur le déni de responsabilité et la réécriture des faits. Elle illustre une tendance plus large : transformer les échecs structurels en simple « héritage » abstrait, tout en neutralisant le débat démocratique par des annonces séduisantes de futurs chantiers. Or gouverner, ce n’est pas seulement inaugurer de nouveaux projets : c’est aussi assumer les choix d’hier. La mémoire publique ne peut se réduire à un exercice de communication.
Ainsi, la question du dessalement, au-delà de son aspect technique, devient un révélateur : elle expose la manière dont l’État gère la rareté, éclaircit la relation trouble entre politique et intérêts privés, et met en lumière la tentation récurrente d’éluder les responsabilités à long terme. En ce sens, l’enjeu hydrique dépasse de loin la seule problématique de la confiance entre gouvernement et société.