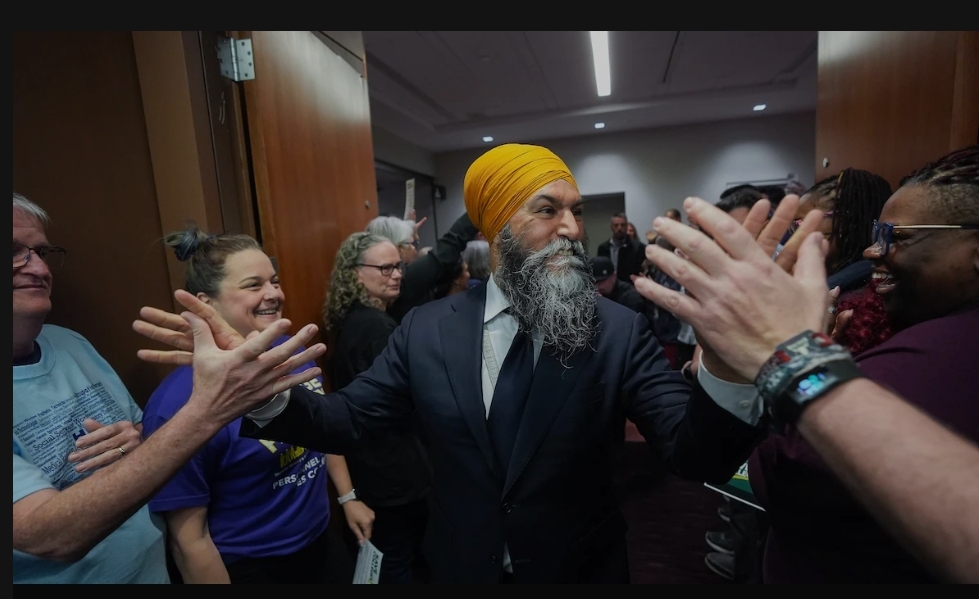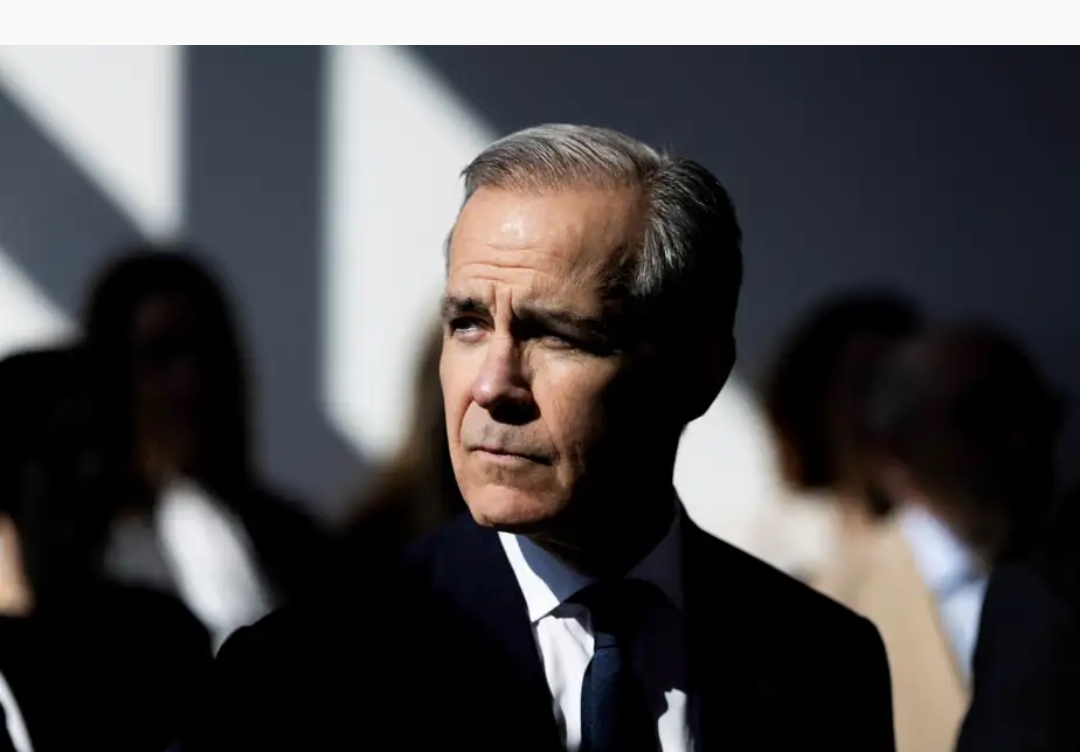Assahafa.com
Le Canada n’échappera pas aux droits de douane réciproques que les États-Unis comptent imposer à leurs partenaires commerciaux dès le 1er avril. La taxe sur les services numériques est dans la ligne de mire du président Donald Trump, tout comme la taxe de vente sur les produits et services (TPS). Or, ce raisonnement ne tient pas la route, estiment des experts consultés par La Presse.
« Le Canada a été très mauvais avec nous en matière de commerce, mais il va maintenant devoir commencer à payer », a affirmé le président américain jeudi alors qu’il répondait aux questions des journalistes dans le bureau Ovale, tout juste après avoir signé son décret sur les droits de douane réciproques. Il a répété que le Canada devrait devenir le 51e État américain pour les éviter.
Les États-Unis veulent imposer ces pénalités pour contrer plusieurs pratiques commerciales à l’échelle internationale comme « des taxes injustes, discriminatoires ou extraterritoriales imposées par nos partenaires commerciaux aux entreprises, aux travailleurs et aux consommateurs des États-Unis, y compris une taxe sur la valeur ajoutée ».
La TPS, qui se retrouve ainsi dans la ligne de mire de Donald Trump, est justement une taxe sur la valeur ajoutée, c’est-à-dire une taxe sur la consommation. Elle s’applique tant aux biens et services produits au Canada qu’aux importations. Cette taxe fédérale est de 5 % dans les provinces qui, comme le Québec, n’ont pas adopté la taxe de vente harmonisée.
La TPS, une barrière ?
« Non, ce n’est pas une barrière commerciale », tranche Patrick Leblond, professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa. « La logique économique de Trump ne tient pas du tout. Ce n’est pas comme si on imposait quelque chose sur les entreprises étrangères qu’on n’impose pas sur les entreprises canadiennes. »
Elle constituerait une barrière tarifaire si elle désavantageait les produits américains, ce qui n’est pas le cas actuellement. Elle s’applique de façon équitable aux biens de consommation vendus au Canada. C’est ce qu’on appelle la règle du traitement national, qui est l’un des principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
« La règle du traitement national veut que les produits nationaux soient taxés de la même façon que les produits étrangers », explique Hervé Prince, professeur à la faculté de droit de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire en gouvernance et droit du commerce international. « Il ne pourrait pas y avoir de discrimination entre la taxation de deux produits similaires importés ou nationaux. »
« La TPS n’est pas très différente de la taxe de vente aux États-Unis parce que ce n’est pas une taxe industrielle. Nous nous sommes débarrassés de ce type de taxe lorsque nous avons adopté la TPS pour avoir une taxe sur la consommation », rappelle Fen Hampson, coprésident du Groupe d’experts sur les relations canado-américaines de l’Université Carleton et de l’Institut canadien des affaires mondiales.
Le décret s’attaque ainsi à des principes fondamentaux qui régissent le commerce international, faisant fi de l’OMC, dont les États-Unis ont déjà affaibli le mécanisme d’appel.
« Le faire, c’est illégal », souligne le professeur Hervé Prince. Tout comme le serait la riposte canadienne.
La Chambre de commerce du Canada a déploré que l’annonce de ces droits de douane réciproques « déstabilise encore davantage l’ordre commercial international qui a rendu une grande partie du monde occidental, en particulier les États-Unis, plus prospère et plus productif ».
Une autre taxe dans le collimateur
La fiche d’information sur le décret publiée par la Maison-Blanche mentionne également la taxe sur les services numériques qui est entrée en vigueur en juin 2024. Cette taxe de 3 % est imposée aux revenus des géants du web.
« Même si l’Amérique n’a rien de tel et que seule l’Amérique devrait être autorisée à taxer les entreprises américaines, les partenaires commerciaux remettent aux entreprises américaines une facture pour ce qu’on appelle une taxe sur les services numériques », indique la Maison-Blanche. « Les droits de douane réciproques ramèneront l’équité et la prospérité dans un système commercial international discriminatoire et empêcheront les Américains d’être exploités. »
Elle accuse le Canada et la France de « recueillir chacun plus de 500 millions de dollars par année » avec cette taxe qui coûte « aux entreprises américaines plus de 2 milliards de dollars par an ».
Renégociation de l’ACEUM
La Maison-Blanche mentionne aussi les barrières commerciales dans le domaine de l’agriculture qui font en sorte que les États-Unis avaient un déficit commercial de 40 milliards en 2024 dans ce secteur. Elle ne précise pas si ces droits de douane pourraient s’appliquer en réaction au système de gestion de l’offre qui s’applique à la production du lait, de la volaille et des œufs au Canada, mais plusieurs experts avaient mis le gouvernement en garde lors de l’étude du projet de loi C-282 visant à protéger ce système.
Il s’agit de deux sources d’irritation pour les États-Unis qui risquent de faire partie de la renégociation de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Le nouveau décret est tellement large qu’il sera difficile pour le Canada d’offrir quelque chose en contrepartie de la levée de ces nouveaux droits de douane, croit M. Leblond.
« Tranquillement, il nous retire tout ce qu’on pourrait monnayer dans un accord parce qu’il rajoute des éléments, fait valoir M. Leblond. Chaque fois qu’on veut qu’il en enlève, il faut lui donner quelque chose. »
L’attaché de presse du ministre des Finances, Dominic LeBlanc, a réitéré que « les droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis seraient avant tout néfastes pour les consommateurs américains ».
Ce nouveau décret vise surtout les pays européens et des pays comme l’Inde et le Brésil où les droits de douane sur les produits américains sont élevés. Il est tellement large qu’il sera difficile à administrer pour les États-Unis, anticipe M. Hampson.
« Ils l’appliquent partout dans le monde, sur tous leurs partenaires commerciaux, et donc devront tout analyser au cas par cas, signale-t-il. Ça va être très compliqué et très long pour le représentant du commerce et son département à un moment où beaucoup de fonctionnaires quittent le gouvernement pour se trouver du travail ailleurs. Bonne chance ! »
Il estime que le Canada réussira à se négocier des exemptions parce que les États-Unis ont besoin des produits canadiens pour faire rouler leur économie.
Source: la presse